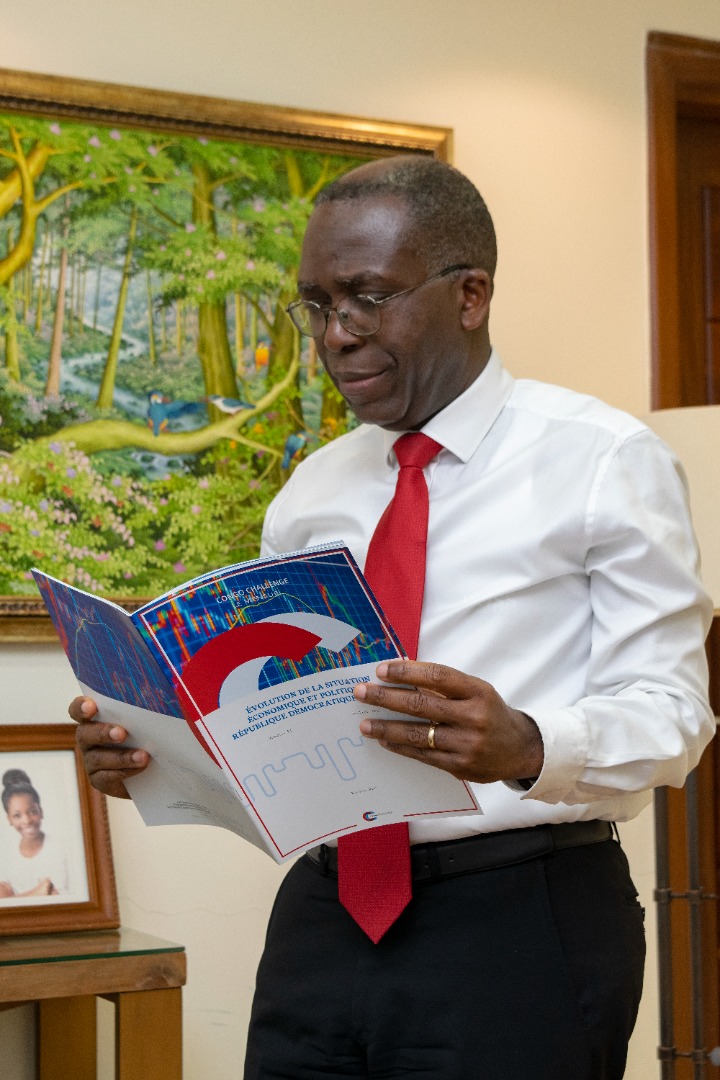Ce que je pense est que lorsqu’un peuple cesse de penser et de réfléchir, son avenir s’assombrit. En effet, l’homme est appelé à trouver continuellement des réponses aux questions fondamentales inhérentes, non seulement à son existence, mais aussi à celle de l’univers dans lequel il vit. Le monde a été créé égal pour tous les peuples. Il est le même pour les blancs, les noirs et les autres races. Dans sa nature sauvage, il recèle toute sorte et forme de richesses. Certaines apparentes, d’autres, pour l’essentiel, cachées. Il a été donné à l’homme la capacité de penser et de réfléchir pour se découvrir et trouver les voies et moyens de déposséder la terre de ses trésors pour son meilleur-vivre. Pour le créateur, l’homme se doit d’utiliser son intelligence pour produire, multiplier la production et la distribuer ; il doit contrôler et dominer le monde. En un mot, grâce à sa capacité intellectuelle, l’homme se doit de transformer le monde. Il doit donc travailler dur, offrir le meilleur de lui-même et rechercher toujours l’excellence.
Ce que je pense est que Dieu n’a créé ni riche, ni pauvre. Il a plutôt donné le pouvoir à l’homme de créer la vraie richesse. Certains peuples ont fait usage de leur intelligence pour répondre à ce défi originel et permanent. Ils ont créé des écoles primaires, secondaires et universités de qualité. Ils ont créé des écoles professionnelles de standard élevé. Ils ont construit de centres de recherche de haut niveau. Ils identifient les meilleures intelligences dès l’école primaire et les accompagnent méticuleusement jusqu’à leur éclosion. Ils pourchassent et attirent les brillantes personnes de tout âge à travers le monde. Ils veulent autant que possible être les détenteurs du savoir du monde. Ils investissent énormément dans l’éducation et la recherche. Ils se remettent en question de manière continue. En définitive, leurs pays ont les meilleures écoles, universités et centres de recherche du monde. Ils ont aussi les meilleures idées et inventions ; de même, leurs scientifiques caracolent dans le classement des bénéficiaires des prix Nobel et autres prix d’excellence de standard international. Enfin, ils ont les meilleures industries et produisent, en quantité et qualité, tout ce dont les hommes ont besoin pour mieux vivre. En plus, ils fabriquent les armes de toute nature pour se protéger et assujettir les autres. Ces peuples sont devenus « riches » et font partie des pays dits « développés ». A l’opposé, les autres peuples recourent peu à la pensée et à la réflexion. Ils ne lisent presque pas, mais parlent beaucoup. Ils sont dans l’école du m’as-tu-vuisme et de la jouissance. Ils investissent très peu dans l’éducation et la recherche. Les écoles et universités sont délabrées, les programmes d’enseignement parfois dépassés, les enseignants et les professeurs mal payés et pas à jour de la pédagogie et de la recherche. Dans leurs pays, les sciences exactes et d’ingénieur sont reléguées au second plan. Celles-ci manquent parfois de professeurs. Inimaginable ! La philosophie, science de la quête permanente de la vérité par un questionnement continu de l’existentialisme, est presque abandonnée. Le système éducatif et d’invention n’est pas compétitif et motivateur. Leurs universités et centres de recherche n’apparaissent presque pas dans le classement mondial y relatif. Les anti-valeurs supplantent les valeurs et deviennent un référentiel de pensée et de production. La culture de la méritocratie s’étiole devant celle de la médiocrité. En définitive, ces peuples n’inventent presque rien. Ils adoptent les idées des autres et essayent de penser comme eux. Ils produisent très peu et la valeur ajoutée y est faible. Alors, ils importent et consomment la production des pays développés. Et le classement des pays selon l’indice du développement humain du PNUD les positionne au bas de l’échelle. Ils sont considérés comme des « pauvres » et vivent dans les pays qualifiés de « sous-développés ».
Ce que je pense est que les dirigeants des pays sous-développés ainsi que leurs peuples doivent cesser de se plaindre pour revendiquer les mêmes types de droits et de respect que les peuples des pays développés. Le respect ne s’octroie pas. Il se mérite. La paix et la sécurité ne se donnent pas, elles s’acquièrent. Ils doivent plutôt se poser la question de savoir pourquoi les autres sont mieux côtés, sécurisés et protégés. Ils comprendront que leur progrès est fondamentalement lié à la maitrise de la connaissance et du savoir, ainsi qu’à l’effort et au sacrifice. Ils comprendront aussi que les institutions internationales où se discutent les grandes questions liées à la marche du monde ont été créées essentiellement pour protéger la suprématie des grands. Ce qui est du reste conforme à la logique de la création de voir les plus forts assujettir les plus faibles. Éthiquement, ces institutions appartiennent aux Nations unies, c’est-à-dire à tous les peuples du monde. Pour certains, la communauté internationale n’existe pas. C’est plutôt un syndicat de pays développés dans lequel sont associés, pour la figuration, les représentants des pays pauvres. Parce que les décisions y sont prises sur base du poids de la production de chaque pays, du reste fruit de la connaissance, du savoir et du dur labeur. Et de manière générale, les décisions profitent aux plus forts qui disposent d’un pouvoir de vote prépondérant. Au conseil de sécurité, certains d’entre eux ont même le pouvoir de véto. Alors, au lieu de se plaindre et de réclamer une justice de faveur, les pays pauvres devraient plutôt investir dans la connaissance et la recherche du savoir pour davantage produire, créer des richesses et se protéger. Sur base de leurs nouveaux poids économiques et financiers, ils seront en mesure de revendiquer la restructuration de toutes les institutions internationales dans lesquelles ils n’ont actuellement aucun pouvoir réel. C’est de cette façon seulement que leurs revendications et droits seront sérieusement prise en compte. Certains pays comme la Chine et l’Inde et d’autres de l’Asie du Sud-est comme la Corée du sud et le Singapour l’ont compris et ont levé l’option de suivre dans le silence cette voie de sagesse et de grandeur. Depuis plusieurs décennies, ils rêvent, pensent, réfléchissent et travaillent dur. Ils produisent la qualité, consomment leurs productions et exportent le surplus. Les résultats sont impressionnants. Leurs voix sont entendues et le seront davantage demain. Le respect et l’honneur s’invitent aussi à leur endroit. La paix et la sécurité aussi. Comme le disait Gérard Papus, ils empruntent la voie de l’évolution et d’éclaircissement. Ils laissent les autres peuples sur la voie de l’involution et de l’obscurcissement. Quitte à eux d’apprendre à penser et à réfléchir.
Paris, le 27 octobre 2022